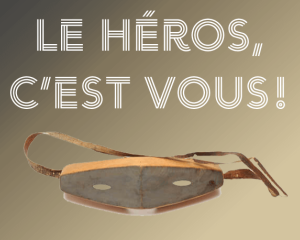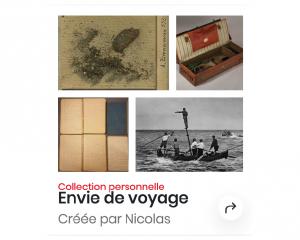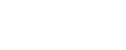Fossile des pyramides
Les blocs de roches des Pyramides de Gizeh (Egypte) sont constitués d’une multitude de minuscules fossiles lenticulaires. Ces coquilles d’organismes unicellulaires sont appelés foraminifères. Le Muséum d’histoire naturelle de Genève en conserve un exemplaire du nom de Nummulites gizehensis ehrenbergi.
Cette coquille minuscule appelée nummulite est l’un des foraminifères (organismes unicellulaires) fossiles les plus célèbres. Extrêmement abondante dans certaines roches des Alpes, elle foisonne aussi dans les blocs de roche qui forment les Pyramides de Gizeh en Egypte. C’est ce qui lui a valu d’être le foraminifère le plus anciennement cité dans la littérature. Strabon (60 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.), géographe et historien, rapporte en effet de sa visite des Pyramides sa grande surprise devant l’abondance de ces « petites pétrifications ayant la forme et la dimension d’une lentille ».
Cette nummulite qui pullulait il y a près de 45 millions d’années dans une mer immense et peu profonde bordant le continent africain, a été baptisée Nautilus gizehensis par le naturaliste Petrus Forskål (1732-1763) en 1775. Il s’est basé sur du matériel provenant des Pyramides de Gizeh et de la colline de la citadelle du Caire pour décrire cette espèce. Plus tard, l’espèce gizehensis a été déplacée dans le genre Nummulites décrit par Lamarck (1744-1829) en 1801.
En 1881, le Vaudois Philippe de la Harpe (1830-1882), qui étudiait les nummulites de Suisse et révisait les autres espèces, a décrit différentes sous-espèces de Nummulites gizehensis, dont Nummulites g. ehrenbergi. Un type (spécimen de référence) de cette sous-espèce, basé sur du matériel provenant de la colline de Mokattam (le Caire), a été déposé dans les collections micropaléontologiques du Muséum. On l’y retrouve aux côtés d’un morceau de roche contenant des nummulites et provenant de Gizeh.